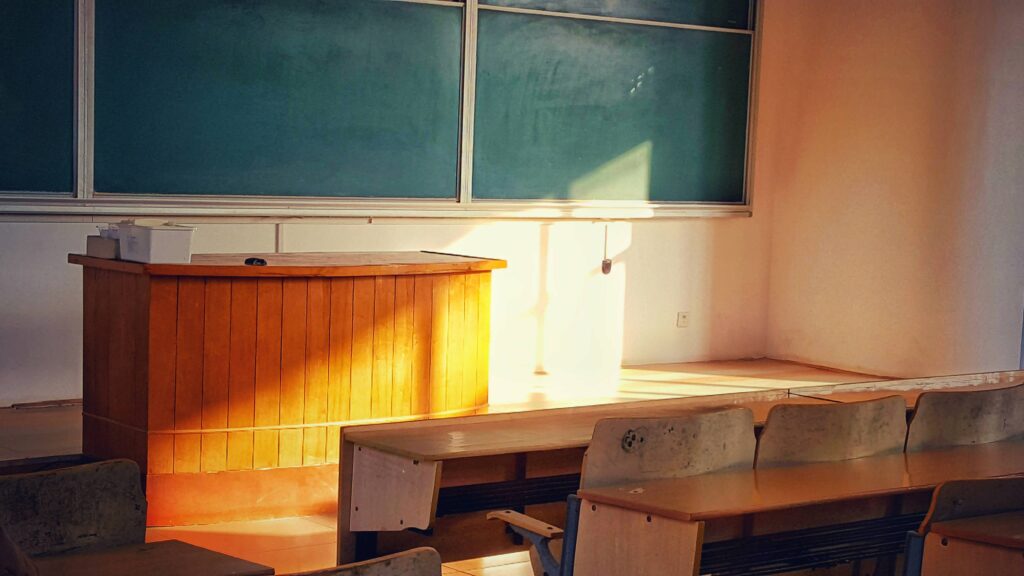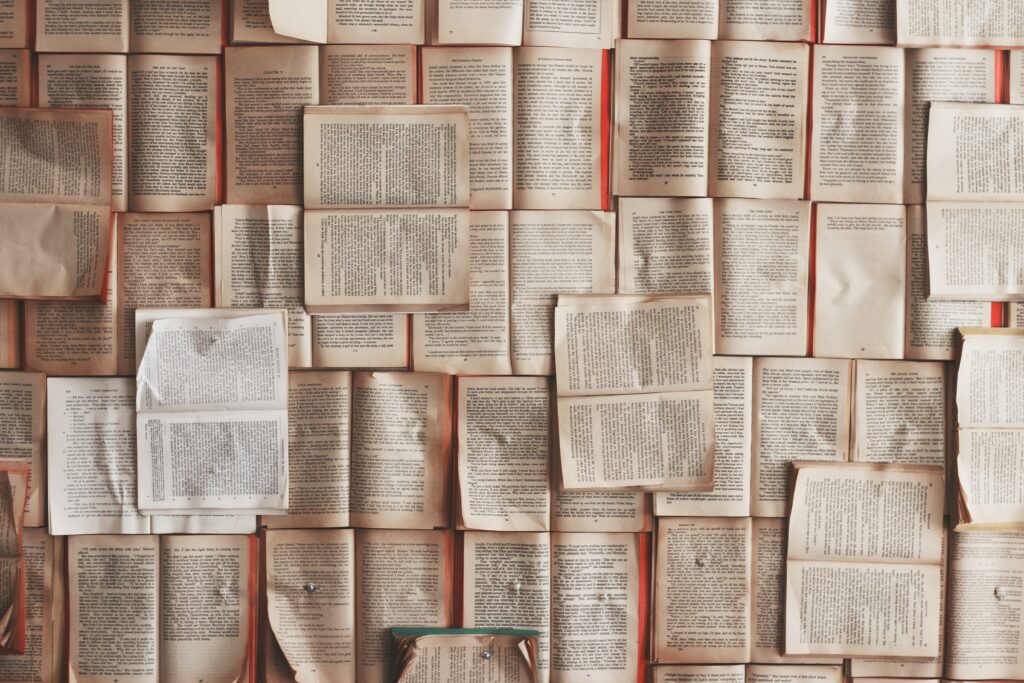Nous parlons dans ce blog des outils d’aide à la décision. Mais d’abord, pourquoi aider la décision ? Les décideurs dont c’est le métier, les humains qui ont évolué pour s’adapter au monde puis l’ont faconné, ont-ils besoin d’aide pour réaliser cette activité de tous les jours: décider ?
Combler nos limites cognitives
Le cerveau humain, comme tous les organes humains, est le résultat d’une évolution qui a été retenue parce qu’elle permettaient aux humains de mieux survivre que les autres. Dans ce processus, l’évolution n’a pas retenu l’humain qui identifiant la solution parfaite entre 25 alternatives.
Le cerveau doit prendre des décisions rapides, pour décider où fuir (avant de se faire manger par le prédateur), où camper (avant que la nuit tombe), quel fruit cueillir, etc. Il doit aussi prendre ces décisions avec un effort réduit. Faire fonctionner le cerveau consomme de l’énergie. Consommer plus d’énergie, c’est avoir besoin de consommer plus de nourriture, mais aussi dédier moins d’énergie à autre chose. Le cerveau utilise des heuristiques (des règles simplificatrices) pour répondre plus rapidement et avec moins d’effort aux problèmes rencontrés. Lorsqu’il doit acheter un produit de consommation, un consommateur ne va pas s’engager dans une comparaison de tous les produits présents dans le rayon, mais va plutôt se concentrer sur des règles simplificatrices, telles quel « je ne prends pas le moins cher, ni le plus cher. Je retiens les 2 ou 3 meilleurs, je cherche à identifier lequel est le meilleur ».
Le cerveau doit prendre des décisions assez correctes pour survivre: ne pas manger de poison, plutôt installer le campement à l’abri des prédateurs, concevoir un outil plus performant. Herbert Simon dira que l’humain cherche des solutions satisfaisantes (satisfycing) et non pas des solutions optimales. Les heuristiques utilisées par le cerveau sont conçues pour obtenir rapidement des réponses pas trop mauvaises.
Notre cerveau n’est donc pas spécialisé dans la prise de décision dans un monde post-industrialisé. Nous faisons avec ce que nous avons, et prenons l’habitude de nous équiper de béquilles pour faire ce que notre système cognitif ne permet pas de faire naturellement. Quelques exemples:
- Nous sommes capable de réaliser du calcul de tête, mais nous avons inventé le boulier, l’algèbre, la règle à calculer, la machine à calculer, la calculatrice, pour réaliser des calculs plus compliqués.
- Nous sommes capables de nous repérer l’espace en créant des cartes mentales de notre environnement habituel, mais nous créons des cartes pour réussir à maîtriser l’ensemble du globe et préparer des déplacements. Quand on parle d’aider la décision, on parle donc bien de venir suppléer des limites de nos capacités innées.
Aider l’individu dans sa décision à éviter les biais cognitifs
La première motivation de l’aide à la décision, celle invoquée notamment en psychologie de la décision, est d’aider le décideur à éviter les biais cognitifs.
Lorsque nous prenons des décisions, qu’elles soient simples ou complexes, nous aimerions penser que nous les abordons de manière rationnelle et logique. Cependant, la recherche en psychologie et en neurosciences a montré que notre processus décisionnel est souvent influencé par un ensemble de biais cognitifs qui peuvent fausser notre jugement.
- Biais de confirmation : C’est la tendance à rechercher, interpréter et se souvenir des informations qui confirment nos croyances préexistantes. Par exemple, si nous croyons que les chats noirs portent malheur, nous sommes plus susceptibles de remarquer les moments où un chat noir croise notre chemin avant un événement malheureux.
- Biais d’ancrage : Lors de la prise de décision, nous avons tendance à nous fier fortement à la première information (ou « ancre ») que nous recevons, même si des informations ultérieures suggèrent une autre décision.
- Biais de disponibilité : Nous avons tendance à nous fier davantage aux informations facilement disponibles ou récentes, même si elles ne sont pas nécessairement les plus pertinentes.
- Biais de représentativité : Nous avons tendance à juger la probabilité d’un événement en fonction de la manière dont il ressemble à d’autres événements que nous connaissons, plutôt que de nous baser sur des statistiques réelles.
- Biais d’optimisme : C’est la tendance à surestimer la probabilité que des événements positifs se produisent dans notre vie et à sous-estimer la probabilité d’événements négatifs.
- Biais de statu quo : Nous avons tendance à préférer maintenir nos décisions actuelles, résistant au changement même lorsque le changement est bénéfique.
Ces biais ne sont que quelques exemples parmi une longue liste. Ils sont le résultat de l’évolution de notre cerveau pour traiter rapidement l’information dans un monde complexe. Ils sont généralement utiles au cerveau dans l’esprit d’une décision rapide et satisfaisante. Les outils d’aide à la décision visent souvent à permettre au décideur d’éviter ces biais.
Aider l’individu à éviter l’influence sociale
à rédiger
Aider l’individu à justifier sa décision
à rédiger

Chercheur, modélisation de systèmes énergétiques pour l’aide à la décision