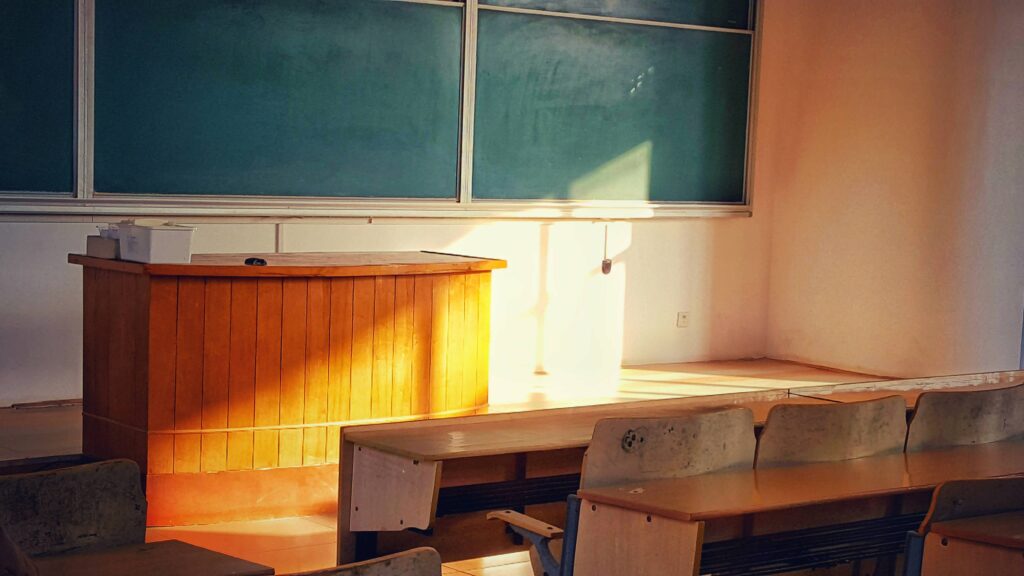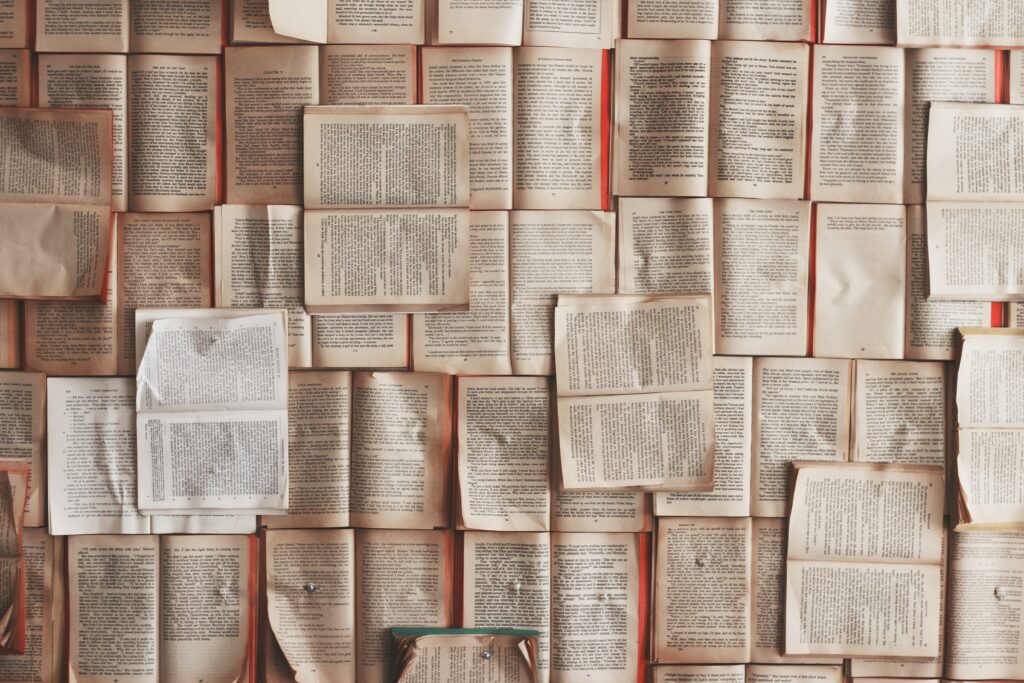Nous traitons ailleurs de la définition de la décision dans plusieurs disciplines scientifiques. Mais les acteurs qui s’intéressent aux outils pour l’aide à la décision partent d’une définition non scientifique de la décision. Nous discutons ici de plusieurs caractéristiques clés de la décision vue dans le langage courant.
décision – nom féminin (latin decisio, -onis)
1. Action de décider après délibération ; acte par lequel une autorité prend parti après examen : Décision judiciaire.
2. Acte par lequel quelqu’un opte pour une solution, décide quelque chose ; résolution, choix : C’est une sage décision.
3. Choix des orientations d’une entreprise, d’une politique, etc. ; mesure, ordre, prix en conformité avec cette orientation : Avoir le pouvoir de décision.
dictionnaire Larousse, 2023
Cerner la décision n’est pas simple quand il s’agit de définir ce qui n’est pas une décision.
La décision est un choix entre plusieurs options…
Décider, c’est choisir une unique option parmis un ensemble de possibilités
La décision est un moment ponctuel dans le temps
« J’ai dû prendre une décision », « nous avons besoin d’acter une décision »; « que nous avons prit cette décision, le contexte était différent ».
A l’échelle individuelle, on peut mentionner « j’ai prit une mauvaise décision quand ».
Dans les organisations (entreprises, gouvernement, associations…) la décision est d’ailleurs un acte qui fait l’objet d’un mémo, de compte-rendu, voire de publication officielle ou de résultat de délibération. On y retrouve succinctement qui a prit la décision, qui a été consulté, les enjeux, les objectifs, les options, et une motivation du choix.
- « Il y a le temps de la pédagogie, de la concertation, du dialogue, et à un moment donné il y a le temps de la décision. » — Xavier Bertrand (Canal Plus – 20 Mai 2007)
Nous discutons par ailleurs (TODO link) le fait que si la décision est actée à un moment précis, le processus de prise de décision est plus difficile à borner dans le temps.
La décision a des conséquences importantes
N’importe quel choix n’est pas qualifié de décision. On ne qualifie pas de décision le fait d’avoir choisi de prendre une baguette ou un pain de campagne à la boulangerie; d’avoir
On en parle d’ailleurs plus tard
Le fait que la décision a des conséquences importantes apparaît dans le fait qu’on évoquera la décision prise plus tard. « Mais qui a prit cette décision ? » « Rétrospectivement, nous avons bien fait de choisir… ».
La décision engage la responsabilité du décideur
En management, le décideur qui a prit une décision en est comptable. On peut lui demander dec comptes formellement (PDG qui rend compte à son conseil d’administration, subordonné qui rend des comptes à son supérieur, etc.).
Dans la vie quotidienne, la décision engage également l’individu qui a réalisé le choix.
L’importance est relative à la situation du décideur…
L’importance d’une décision est subjective. Elle dépend du décideur et de son contexte.
Dans la décision d’un consommateur par exemple (décider de réaliser tel investissement, d’acheter tel bien ou service), la capacité financière de l’acheteur relativise l’importance de la décision. Un foyer aisé pourra se remettre d’une mauvaise décision: il pourra absorber le surcoût d’une mauvaise opération immobilière ou payer les travaux inattendus, pourra remplacer le véhicule non fiable par un autre véhicule, etc. Un autre foyer aux capacités financières plus modestes pourra être durablement mis en difficulté par une mauvaise décision, jusqu’à par exemple être dans l’incapacité de maintenir un logement salubre, ou de se rendre au travail faute de véhicule adéquat.
De même en management, un manager qui prend une décision aux conséquences stratégiques importantes pour son entreprise peut risque la survie de son entreprise si celle ci est dans une situation globalement saine, ou mettre en péril la survie de son entreprise.
L’importance est subjective
… l’importance n’est pas toujours perçue au moment de la décision
Des choix de politiques gouver
La décision est le résultat d’une réflexion
La décision est le résultat d’un processus délibératif individuel (on y a réfléchi, on a posé le pour et le contre) ou collectif (il y a eu mise à l’agenda du choix à arbitrer, des plusieurs acteurs ont été consultés).
le management à l’intituion
Certains managers revendiquent la décision à l’instinct. Ils sont parfois nommés dans des taxonomies de décideurs des « décideurs intuitifs ». Ces décisions ne sont pas définition pas basées principalement sur une réflexion.
La décision est parfois déléguée
Si la décision est le résultat d’un processus délibératif, ce processus n’est pas toujours une réflexion individuelle originale et libre. Il y a plusieurs cas dans lesquels la décision est déléguée à une source externe qui présidera à la décision à la place du décideur.
s’en remettre au sort
On peut déléguer une prise de décision au hasard. Le tirage au sort est peu courant dans la vie quotidienne des sociétés occidentales. Pourtant dans certains cultures, des décisions importantes sont prises en s’appuyant sur un oracle. TODO exemple du choix de la maison. Beaucoup de parents décident en Chine du moment auquel faire un enfant en se basant sur la numérologie (TODO ref nécessaire).
Le tirage au sort a été utilisé pour décider des personnes à retenir dans une vaste population:
- Pendant longtemps, la conscription, c’est-à-dire la décision d’engager des milliers d’hommes dans le service militaire pour une durée importante, était réalisée par tirage au sort (notamment en France, Belgique ou aux Pays Bas). En France entre 1872 et 1905, chaque appelé tirait un numéro; celui qui « tirait le bon numéro » servait un an au lieu de cinq. Toutefois toutes ces procédures aléatoires constituaient une base à laquelle il était possible de déroger pour des raisons physiques ou en usant de passe-droits.
- de nos jours en France, les jurés d’assises sont encore tirés au sort dans la population des citoyens de plus de 23 ans
- un quota de « green cards », sésame permettant de résider de façon permanente aux états-unis, est attribué chaque année par loterie
Quand la décision est trop incertaine, il peut être impossible de choisir quelle est la meilleure option. En investissement boursier, plusieurs études indiquent que faute de pouvoir prédire la rentabilité future de différents assets, le choix aléatoire demeure la meilleure solution (voir les travaux d’Albert Cowles [1], ou l’étude qui démontre qu’un choix aléatoire bat les modèles mathématiques utilisés par les investisseurs [2]).
déléguer à un outil, une méthode, un protocole
La décision est souvent déléguée à un outil ou à une méthode. Cette méthode est parfois aléatoire; ainsi la décision d’attribuer telle ou telle formation à un candidat est réalisée partiellement aléatoirement dans l’outil ParcourSup.
La décision peut s’angcrer sur un protocole ou une méthodologie à laquelle on se reporte de façon quasi automatique. C’est notamment le cas:
- en médecine où des protocoles font consensus au sein des spécialistes, sont formalisés sous forme de protocoles, voire sont préconisés par une instance spécialisée. Ainsi l’oncologue se décide pas seul, dans chaque situation, du traitement à administrer.
- un grutier qui doit décider de mettre sa grue en girouette ou non, en fonction des conditions météorologiques, n’est pas (plus) seul dans sa décision, mais s’appuie sur une réglementation qui contraint sa décision. Voir l’étude de cas sur l’accident de la grue de Toul.
Dans de nombreuses situations, il est difficile de réaliser un choix informé
Dans certains situations, il est matériellement difficile de comparer des options. C’est dans les situations de catastrophes (accidents, service d’urgence saturé, médecine de guerre…) dans lesquelles il faut procéder à un triage médical. Dans ces situations, le temps manque pour analyser chacune des options. Par ailleurs le choix peut être difficile pour des raisons éthiques. On se reporte ici encore à des règles prédéfinies (« les femmes et les enfants d’abord », « premier arrivé premier servi ») qui permettent de répondre au double besoin impérieux de prendre la décision et de pouvoir défendre la décision prise.
déléguer à une commission, une instance
déléguer la responsabilité à un processus tiers. Plutôt qu’arbitrer lui-même, le décideur peut déléguer la décision à un organe tiers, commission
« Si vous voulez enterrer un problème, nommez une commission » Clemenceau
La décision est parfois implicite
Il arrive que les grandes décisions ne se prennent pas, mais se forment d’elles-mêmes.
HENRI BOSCO (Avignon 1888-Nice 1976)
Il n’est pas de problème qu’une absence de solution ne finisse par résoudre
Henri Queuille
Le cas le plus typique est de renoncer à décider.
Références
- (1999): Aux origines de la mesure de performance des fonds d'investissement. Les travaux d'Alfred Cowles. Dans: Histoire & Mesure, p. 163–197, 1999.
- (2013): An evaluation of alternative equity indices-part 1: Heuristic and optimised weighting schemes. Dans: Available at SSRN 2242028, 2013.

Chercheur, modélisation de systèmes énergétiques pour l’aide à la décision