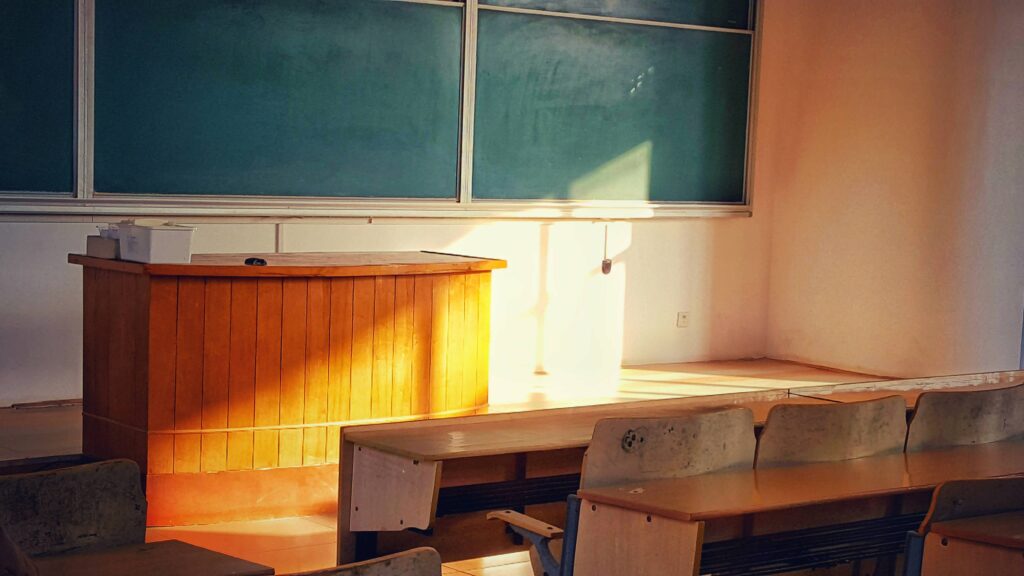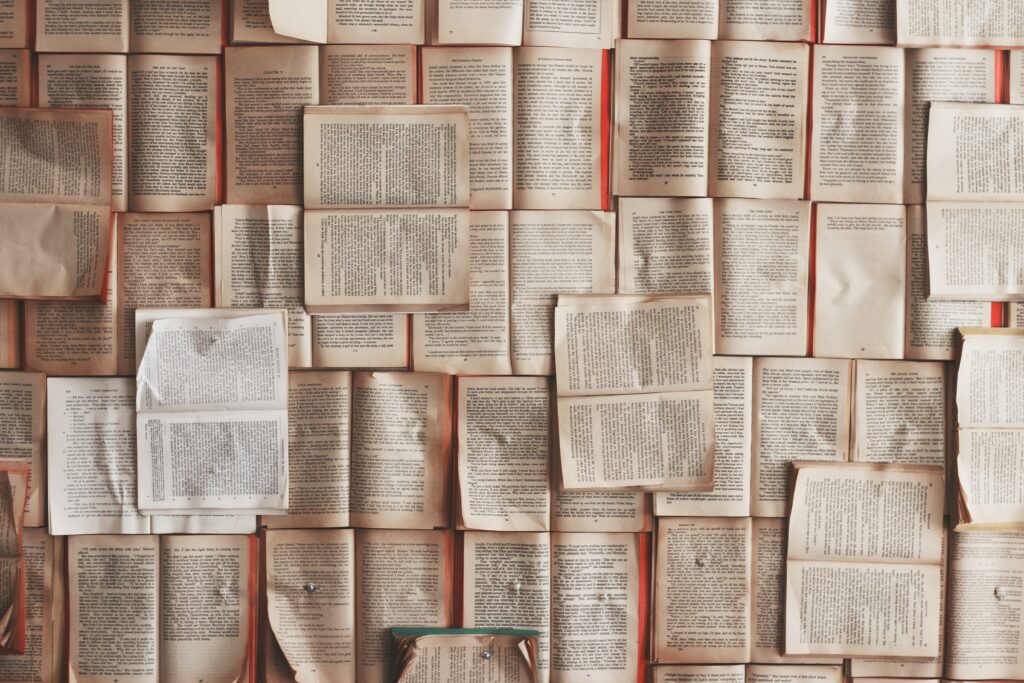L’accident de grue de Toul est un cas d’étude intéressant pour l’aide à la décision. Nous en retenons:
- La décision a des conséquences graves et irréversibles (décès de tiers)
- La décision qui semble prise par le seul grutier est en réalité prise collectivement par le chef de chantier et le grutier. C’est précisément dans cette dynamique entre les deux personnes en situation de décider que la mauvaise décision est prise.
- Cette décision est le résultat d’une chaîne d’évènements (délégation de la sécurité à un chef de chantier inexpérimenté) et d’un contexte réglementaire (anémomètre pas obligatoire).
- Des instruments auraient permis d’améliorer la prise de décision (anémomètre). Pourtant les informations nécessaires étaient présentes dans les bulletins météo.

Le 26 janvier 1995 à Toul, une rafale de vent a fait basculer une grue sur le toit du lycée voisin. 6 élèves ont été écrasés par le lest et 10 blessés[1]. Le grutier a été retrouvé sans connaissance après la chute de 30 mètres. Polytraumatisé, il conservera des séquelles graves de cet accident. Avant cet accident, le grutier était descendu deux fois de sa grue pour signaler que le vent était trop violent et qu’il devait interrompre le travail. Ces deux fois, le chef de chantier lui avait demandé de continuer le travail pour traiter le béton frais reçu sur le chantier.
Au delà des dégâts humains importants, l’accident est célèbre pour son traitement juridique: bien que victime de l’accident, le grutier a été mis en examen — et déclaré coupable ! — d’homicides et blessures involontaires. L’accident de Toul est souvent utilisé dans les formations en sécurité ou en droit, pour rappeler les responsabilités qui incombent à un professionnel: c’est bien le grutier qui a continué à travailler en dépit du vent, et c’est lui qui était tenu de suspendre son travail en exerçant son droit de retrait. Même l’autorité du chef de chantier n’aurait pas dû l’empêcher de prendre la décision d’interrompre le travail.
La cause de l’accident est la décision – rétrospectivement mauvaise – de continuer à utiliser la grue en dépit des vents élevés, au lieu de la « mettre en rideau » (la débrayer, pour qu’elle tourne en fonction de vent comme une girouette, ce qui diminue sa prise au vent).
Un jugement plus nuancé
Le fait que le grutier ait été condamné en dépit de ses alertes répétées en fait un exemple pédagogique des responsabilités. Pourtant, le jugement de cette situation a été plus complexe, et a marqué la législation par des évolutions juridiques.
Tout d’abord, le grutier a été condamné à une peine considérée comme symbolique (un amende avec sursis).
[2]Délégation
decision support canevas
Quel est le stimulus qui a amené les parties prenantes à prendre une décision ?
Météo France a signalé
qui sont les décideurs ?
L’intérêt pour le traitement juridique de l’affaire de Toul est précisément d’identifier les responsabilités. Le jugement reconnaît que le grutier aurait dû exercer son droit de retrait; c’est lui qui, contraint par le chef de chantier, a décidé de continuer le travail au lieu de refuser frontalement de continuer le travail. Dans cette première vision, c’est bien le grutier qui est le décideur, lui qui fait face au choix « monter » ou « ne pas monter ».
Pourtant le jugement, et le jugement en appel, sont venus tempérer fortement cette analyse. Si le grutier est en effet responsable de cette décision, le chef de chantier portait la responsabilité de la sécurité du chantier, et aurait dû accepter la recommandation du grutier d’arrêter le travail. De fait, c’est bien le chef de chantier qui s’est opposé à la volonté du grutier de cesser le travail. La décision a littéralement été prise à deux: le grutier souhaitant l’arrêt du travail, mais a prit la décision ne pas refuser de remonter; le chef de chantier a forcé l’option de continuer, mais ne porte pas seul la responsabilité, puisque le grutier aurait pu refuser de remonter. Certes, le grutier avait en théorie la possibilité légale d’exercer sont droit de retrait.
Pourtant le jugement retient son statut précaire qui le rendait vulnérable à une mauvaise réputation [3], ce qui mettait le chef de chantier en situation de force vis à vis de lui: « il pouvait légitimement penser qu’en exerçant son droit de retrait, il s’exposait à ce qu’il soit mis immédiatement fin à sa mission d’intérim ». D’autres ouvriers du chantier notent d’ailleurs les nombreux changements de grutiers sur ce chantier, 4 en 2 mois [1]. Le jugement retient ensuite que le grutier pouvait méconnaître sa protection dans le cadre légal du droit de retrait. Dans cette situation, le décideur n’est donc pas uniquement le grutier comme il y paraît au premier regard, mais aussi le chef de chantier qui doit partager la décision individuelle du grutier pour qu’elle puisse s’appliquer en réalité.
D’autres personnes auraient pu devenir parties prenantes de la décision. Une réunion de chantier avait lieu pendant cet épisode. Les acteurs présents (architecte, etc.) ont-ils entendu la discussion, auraient-il pû intervenir ? Auraient-ils même pu prendre l’iniative et questionner la pertinence de gruter dans ces conditions météorologiques ? La démarche judiciaire ne leur a pas attribué de responsabilité légale, mais on peut se demander quel était leur pouvoir d’influence potentielle dans cette décision.
quelle est l’information disponible pour les décideurs ?
Météo France avait prévu et suivi cet épisode météorologique. Le phénomène était prévisible, prévu, et les bulletins météorologiques étaient publiés [4]. . Le jugement ne mentionne pas si les décideurs étaient au courant de cette information.
Le grutier, en haut de la tour, est bien placé pour ressentir les rafales de vent. Il descend de la tour pour signaler qu’il faut arrêter.
Le chef de chantier exprimera quand à lui que « Ce jour-là, je ne sentais pas le vent très fort », et « Il ne me semble pas que le vent a soufflé si fort. Pour moi, il n’y avait pas d’urgence » [1]. Afin de lui faire partager sa perception du vent, le grutier lui a proposé de monter jusqu’à la cabine pour se rendre compte lui-même de la situation, ce que le chef de chantier n’a finalement pas fait. Il semble donc que le chef de chantier ait ignoré l’information transmise par le grutier, et ait préféré croire sa propose perception (subjective) des conditions météorologiques.
Les autres ouvriers et intervenants sur le chantier semblaient être au courant de la météo particulière. Les conducteurs du camion toupie qui livre le béton mentionnent qu’ils n’ont livré que ce chantier, car les autres étaient fermés [1]. Il n’est pas possible a posteriori de savoir si le chef de chantier était au courant de cette information sur le contexte plus global.
Quels outils auraient pu aider cette décision ?
L’anénomètre, pour objectiver ?
Une analyse mentionnera d’ailleurs que ce modèle de grue n’était pas équipée d’anémomètre [4]. La réglementation française n’imposait pas l’anémomètre à cette époque. Un anémomètre aurait permis d’objectiver la force du vent qui n’aurait plus été un simple ressenti, difficile à partager, par le grutier. Cet objectivation aurait permit au grutier de convaincre l’autre décideur, le chef de chantier, de la justesse de son argument.
Il est intéressant de noter qu’un anémomètre aurait certes apporté une données nouvelle, locale, accessible aux parties prenantes, incontestable, et aurait vraisemblablement éviter cette erreur. D’ailleurs sur les 5 grues en service ce jour là, les deux seules arrêtées à cause du vent étaient celles dotées d’un anémomètre et d’un système d’alarme [4]. Pourtant, l’information était présente dans des bulletins météo suffisamment accessibles pour que les autres chantiers aient déjà cessé le travail. Pendant le procès, il apparaîtra d’ailleurs que Météo France avait été appellé trois jours plus tôt. Ce n’est donc pas uniquement une question d’information indisponible, mais plutôt une question d’information immédiatement accessible et incontestable.
La CNAM recommande maintenant de souscrire un abonnement à Météo France (ou de s’informer), et recommande l’installation d’un anénomètre [3].
Par la suite, non seulement toutes les grues ont été équipées d’anémomètres, mais des abonnements d’information ont été souscrits [4].
la réglementation
L’absence d’anémomètre est elle-même le résultat de choix passés qui ont préféré ne pas installer un équipement supplémentaire coûteux (à acheter, entretenir…) qui n’était pas indispensable dans la réglementation [3]. C’est d’ailleurs l’évolution réglementaire qui a ensuite conduit à équiper l’ensemble de ces
La formation et l’expérience
Indépendemment de sa responsabilité dans sa fonction de chef de chantier, on discutera pendant le procès des compétences de ce jeune chef de chantier pour exercer sa responsabilité. Il se dira lui-même manquant de formation et d’expérience sur cet aspect [4].
la délégation
En appel, la responsabilité du responsable du comité d’hygiène et sécurité de l’établissement utilisant la grue sera retenue [5]: « indépendamment des délégations qu’il a données, il a commis une faute personnelle en s’étant abstenu de concevoir le fonctionnement de la hiérarchie sous ses ordres et de l’organigramme de l’agence de manière telle que les insuffisances de la sécurité lui soient rapportées et qu’il y soit remédié. Le fait de n’avoir pas imposé dans l’entreprise des moyens de contrôle et de prévision objectifs de la vitesse des vents a été déterminant dans la réalisation de l’accident. Alors qu’il avait les moyens de l’éviter, il a commis les infractions d’homicide et de blessures involontaires ».
La délégation sera également discutée pour en lever le flou; a ainsi été considéré responsable le supérieur qui a délégué la responsabilité de la sécurité à plusieurs personnes, ce qui rend cette délégation inopérante [3]
Discuter de la délégation, c’est à la fois discuter de qui était le décideur (et où sont les responsabilités), mais aussi relever la responsabilité de celui qui a investi une personne du rôle de décideur.
- parties prenantes de la décision: les autres employeurs potentiels
- Tiers impactés (identifié ex ante)
- tiers impactés ex post: législation
- Processus codifiés : règles pro
- fréquence pour le décideur:quelques fois par vie
Références
- (1997): Défauts d'anémomètre, de formation et de bon sens concoururent à l'effondrement d'une grue, par grand vent, sur un lycée de Toul. Dans: Le Monde, 1997.
- (1991): Accidents du travail Le jugement de Toul relance le débat sur la sécurité. Dans: Le Moniteur, 1991.
- (1997): Accidents du travail Le jugement de Toul relance le débat sur la sécurité. Dans: Le Moniteur, 1997.
- (): . .
- (2002): Bilan et perspectives sur les évolutions de la jurisprudence en matière d'accident du travail. Dans: Le Moniteur, 2002.

Chercheur, modélisation de systèmes énergétiques pour l’aide à la décision