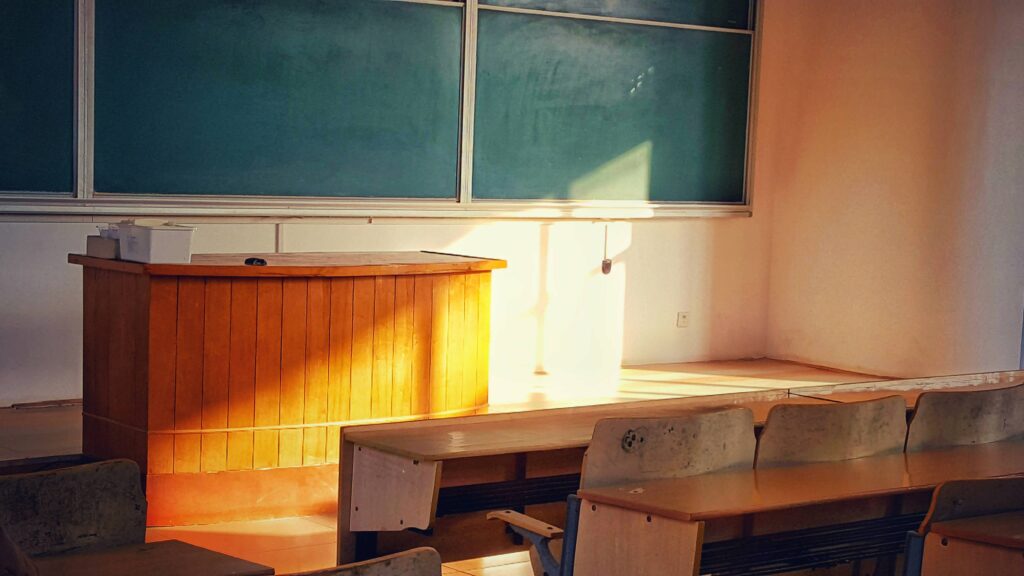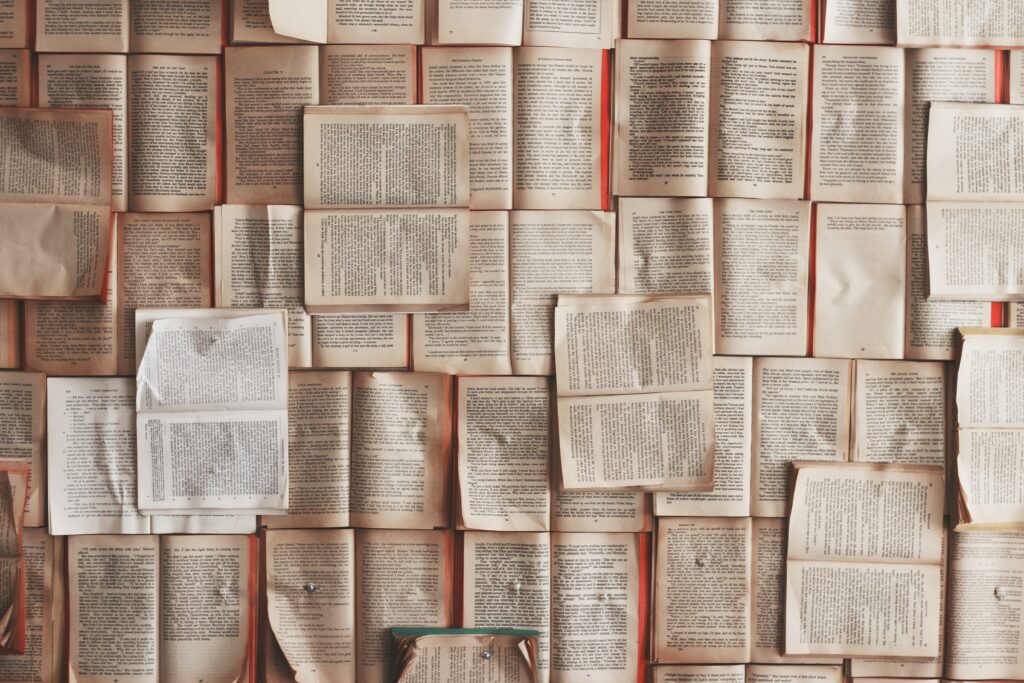Comment créer et mettre en oeuvre des outils numériques pour aider la prise de décision ? Nous sommes nombreux à penser que les nouvelles technologies (modélisation, simulation, systèmes d’information, capteurs, systèmes d’information, etc.) peuvent aider la prise de décision. Pourtant, les démarches d’aide à la décision ne sont pas toujours aussi efficaces que nous le souhaiterions, tant du côté des producteurs de solutions que du côté des décideurs. Ce blog scientifique cherche à améliorer cet état de fait.
Nous discutons plusieurs questions pour expliciter ce qu’est la décision, et explorons les façons d’aider chacune de ces décisions.
Qu’est-ce que la décision ?
Pour aider la prise de décision, il faut d’abord savoir ce qu’est la décision que l’on souhaite aider par des outils et méthodes. Cette question n’est pas triviale: il existe plusieurs visions de la décision:
la décision vue comme un choix
La décision est un choix entre plusieurs options réalisé par un décideur qui cherche à choisir la meilleure option en fonction des conséquences de ces différentes options. C’est la vision classique de la décision, portée notamment en économie. Plusieurs types de décision sont définis en fonction de la nature du système sur lequel on prend une décision (décision dans l’incertitude si les conséquences ne peuvent être estimées que sous forme de probabilités), et en fonction de la façon d’évaluer la qualité des solutions (décision multi-critères si on a besoin d’évaluer la décision sur plusieurs dimensions).
Cette vision de la décision a pour avantage de cadrer précisément ce qu’est la décision.
Il existe de nombreuses façons d’aider un décideur à choisir la meilleure option parmi plusieurs en fonction de ses préférences:
- aider à évaluer les conséquences d’une option. En dehors des modèles, de nombreuses démarchent cherchent à anticiper les conséquences d’une action qui pourrait être choisie par un décideur: étude d’impact (environnemental par exemple) d’un projet. Dans le cas des politiques publiques, des modèles ont été conçus pour évaluer les conséquences d’une politique publique (notamment en microsimulation). Les modèles « what if? » (notamment des modèles multi-agent) sont un cas particulier de modèle qui cherche à analyser l’impact d’une action sur un système complexe.
- aider le décideur à s’affranchir de ses biais pour prendre une décision rationnelle au sens de ses objectifs et des données du problème. C’est le cas des approches normatives.
Cette vision classique de la décision souffre de nombreuses limites:
- on parle d’un « décideur » comme une unique personne. Or les décisions sont rarement individuelles: même quand une personne dépositaire est dépositaire du pouvoir de choisir, elle réalise ce choix en fonction des conséquences sur plusieurs parties prenantes, et se fait conseiller par plusieurs personnes (le pouvoir de décision est d’ailleurs souvent lié à une obligation de consultation préalable). En pratique d’ailleurs, les décisions sont prises par une organisation (par une équipe, une organisation, un conseil), voire sont explicitement des processus pluripartites (cas typique des politiques publiques)
- il est difficile d’isoler la décision comme un choix à un instant T. On peut en effet relever une décision comme une personne ou un organe de décision qui a choisi un choix à un moment donné. Le seul choix ne peut exister sans de nombreuses étapes préalables: quelles sont les options parmi lesquelles choisir ? Comment évaluer la qualité d’une décision, quels sont les objectifs, les contraintes, les enjeux ? D’ailleurs, pourquoi prendre une décision à ce sujet ?
plus généralement, nous avons identifié d’autres cas dégénérés de décision dans lesquels le décideur n’a pas d’objectifs, ne cherche pas la rationnalité, refuse la responsabilité de décideur, etc.
la décision vue comme un processus
La vision la plus large de la décision est donc de traiter non seulement le choix entre plusieurs options (la décision proprement dite), mais le processus qui permet de construire cette décision (en anglais decision-making, c’est à dire la fabrique de la décision).
Le processus de décision inclut de nombreuses étapes qui peuvent être l’objet de démarches d’aide à la décision:
- mettre une problématique à l’agenda d’un organe de décision pour lancer le processus de décision. L‘agenda-setting désigne la mise à l’agenda dans une organisation ou une politique publique. Sur des sujets complexes, la mise à l’agenda peut s’appuyer sur des outils numériques. C’est typiquement le cas du changement climatique, qui a été mis à l’agenda public par la convergence de nombreux travaux du GIEC
- évaluer la trajectoire du système hors action (scénario « business as usual »): on analyse l’état futur du système sans prise de décision, afin de justifier le besoin d’une action (mise à l’agenda), comparer des scénarios alternatifs (éviter le scénario business as usual)
- évaluer la trajectoire du contexte qui influe le système mais n’est pas à la main du décideur (prospective)
- instruire les options en ajoutant des options (étendre le choix des possibles) ou en supprimant (réduire, prioriser, créer une short liste…)
- évaluer les conséquences d’une ou plusieurs options
- comparer les résultats de plusieurs options sur plusieurs dimensions
Qui décide ?
Nous l’avons mentionné plus haut: le décideur n’est quasi jamais solitaire.
le décideur est un ensemble de parties prenantes
nombreuses autres façons d’aider la prise de décision
- créer une compréhension commune de l’état initial. C’est le rôle du diagnostic.
- créer une compréhension commune du problème
- converger sur des objectifs communs
- créer une compréhension partagée de la dynamique du système
- comprendre les enjeux des autres parties prenantes
Quelle type de décision ?
Dans plusieurs domaines (management, etc), on a fait apparaître des caracétirstiques qui différencient des décisions.
importance de la décision
fréquence de la décision
La fréquence de la décision pour le décideur est cruciale pour un
Nature du système
système fortement évolutif
Dans un tel système, l’information récente constitute une information précieuse pour le décideur
système de grande ampleur
Une base de données peut aider àa la décision
système complexe

Chercheur, modélisation de systèmes énergétiques pour l’aide à la décision