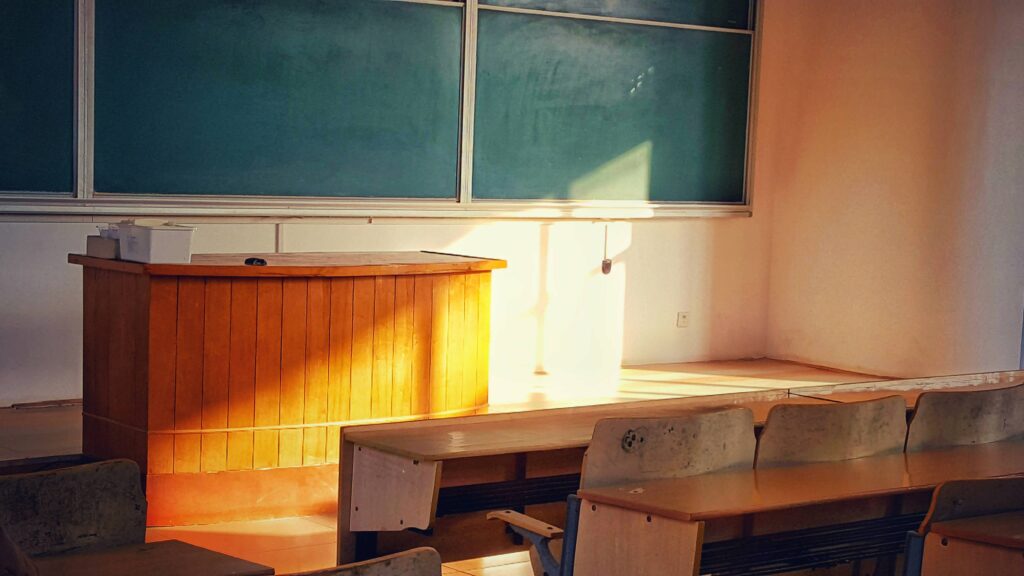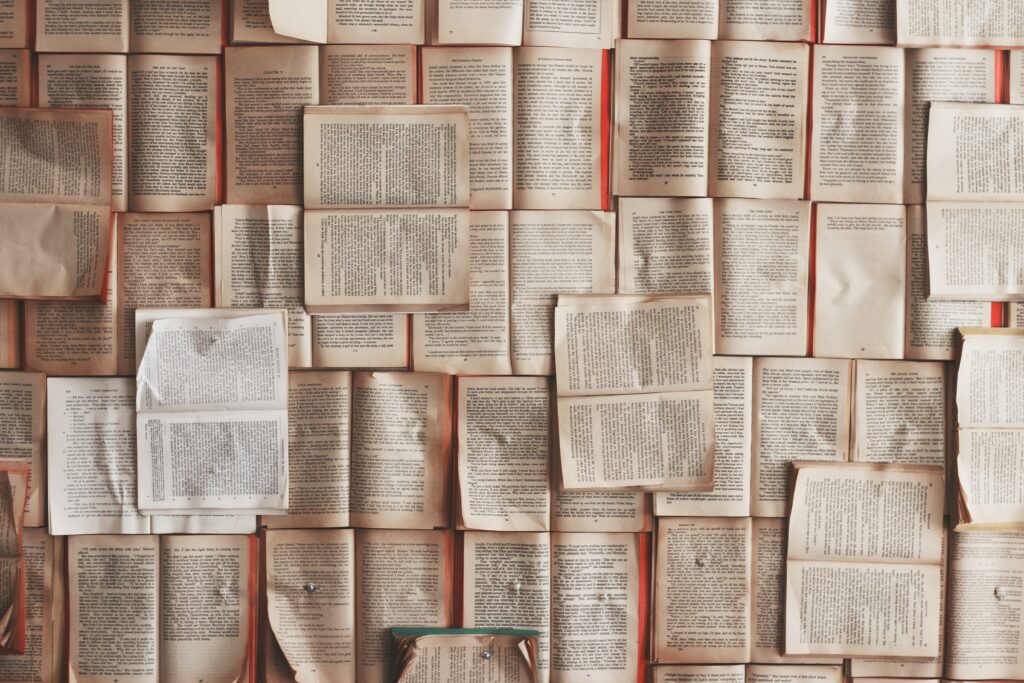une mesure de contrôle:introduire un prédateur
On entends parfois (par exemple ici ou là) le récit des lapins importés en Australie par les colonisateurs, qui ont proliféré dans cet environnement favorable dans lequel ils n’avaient pas de prédateurs. Des renards auraient alors été introduits pour réguler cette population. Malheureusement, au lieu de chasser les lapins comme prévu, ces renards se seraient retournés contre d’autres espèces locales non adaptées à ce prédateur. Cette histoire résume comment l’humain prend de mauvaises décisions lorsqu’il s’efforce de contrôler des écosystèmes plus compliqués qu’il ne le pensait.
L’anecdote semble fausse dans ses détails. Les lapins ont certes été importés volontairement par un britannique chasseur et nostalgique de ses proies à poils, Thomas Austin, qui a prit la décision (rétrospectivement catastrophique, mais qui lui aura permit de passer à la postérité ) de libérer 22 couples de lapins Européens sur le territoire, qui ont effectivement crû et multiplié en l’absence de prédateurs. Des renards semblent avoir été introduits par d’autres chasseurs (décidément bons connaisseurs de la nature !) pour pratiquer la chasse au renard. Certains de ces renards auraient été libérés, auraient pu se multiplier grâce à la population de lapins, avant de se retourner contre les espèces endémiques[1]. L’introduction des renards n’aurait donc pas été remisée dans le but de reguler les lapins, même s’il est vraisemblable que quelques agriculteurs céréaliers aient facilité leur diffusion pour protéger leurs cultures [2]. Les populations de renards ont effectivement décimé de plusieurs espèces locales, dont les marsupiaux. Toutefois, les renards semblent contribuer à la régulation de l’espèce invasive des lapins — c’est d’ailleurs le seul impact positif identifié sur l’écosystème.
Si l’anecdote est fausse (les renards n’ont pas été introduits par les autorités), sa morale est vraie. D’autres situations sont documentées où l’on a introduit un prédateur pour réguler une espèce invasive, où ce prédateur se retourne principalement contre des espèces endémiques.
Histoire similaire aux iles Keegelen où des chats ont été introduits pour reguler les rats amenés par les bateaux. « les chats ont été introduits en 1950 pour endiguer la prolifération des rats qui avaient eux-mêmes été introduits involontairement par des baleiniers au xixe siècle. Malheureusement, les pétrels sont plus faciles à chasser que les rats… Malgré les difficultés rencontrées pour s’acclimater, grâce à ces oiseaux, certains chats ont pu s’installer définitivement et sont redevenus sauvages. Quelques chasseurs ont bien essayé de les éliminer mais en vain. Les félins ont commencé à se multiplier et la population des pétrels a dramatiquement baissé. Lorsque le nombre de pétrels ne fut plus suffisant pour nourrir tous les chats, ceux-ci ont alors mangé les lapins. Un nouvel équilibre est apparu entre les populations de chats et de lapins, au détriment des espèces de pétrels. «
intérêt
On peut questionner l’objectif: faut il réellement empêcher une espèceexogene de se propager ? Image idéalisée [3]
plus largement [4]
Références
- (2010): The impacts and management of foxes Vulpes vulpes in Australia. Dans: Mammal Review, vol. 40, no. 3, p. 181–211, 2010.
- (2011): The importation, release, establishment, spread, and early impact on prey animals of the red fox Vulpes vulpes in Victoria and adjoining parts of south-eastern Australia. Dans: Australian Zoologist, vol. 35, no. 3, p. 463–533, 2011.
- (2016): Les espèces invasives. Dans: Revue juridique de lenvironnement, vol. 41, no. 3, p. 497–507, 2016.
- (2011): L’analyse économique du contrôle des invasions biologiques: Une Revue de Littérature. Dans: Revue d'économie politique, no. 4, p. 489–525, 2011.

Chercheur, modélisation de systèmes énergétiques pour l’aide à la décision